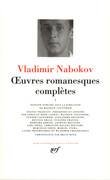La Pléaide
Recherche rapide
Le Cercle de la Pléiade
- La Pléiade /
- La vie de la Pléiade /
- Les coulisses de la Pléiade /
- Les œuvres posthumes


-
Nouveauté
Howard Phillips Lovecraft
RécitsParution le 17 Octobre 2024
En savoir plus
1408 pages, Prix de lancement 69.00 € jusqu'au 31 12 2024
-
L'actualité de la Pléiade
D. H. Lawrence, « Femmes amoureuses », chapitre XIV, extrait. Novembre 2024En savoir plus
Les œuvres posthumes : quand, pourquoi, comment
La lettre de la Pléiade n° 63Avril 2018
Il y a tant de livres à lire, pourquoi s’intéresser à ceux que leur auteur n’a pas lui-même donnés au public ? Mille bonnes raisons à cela, et celle-ci, qui vaut ce qu’elle vaut : ce qui est caché excite la curiosité. Par ailleurs, la question a un envers : qu’arriverait-il si nous n’avions d’yeux que pour les œuvres publiées du vivant de leur auteur ? C’est simple, le paysage littéraire en serait bouleversé. Le grand livre de Casanova serait l’Icosameron, il faudrait s’accommoder d’un Kafka sans Château ni Procès et d’un Chateaubriand sans Mémoires d’outre-tombe, ce qui reviendrait, on peut le craindre, à donner raison à Flaubert : « Chateaubriand : Connu surtout pour le beefsteak qui porte son nom. »
Une précision toutefois : tous les livres publiés après la mort de leur auteur n’étaient pas voués à demeurer cachés. Restée (probablement) inachevée, et en partie seulement préparée pour l’impression, l’Histoire de ma vie était destinée à la publication. Et les Mémoires d’outre-tombe sont le legs du vicomte à la postérité, le monument supposé garantir sa survie. En écrivant « assis dans [s]on cercueil », et en demandant que ses Mémoires ne paraissent qu’après sa mort, Chateaubriand estime pouvoir être plus véridique qu’il ne le serait s’il laissait circuler le livre de son vivant. Il pense aussi qu’une parution d’«outre-tombe» conférera à sa voix «quelque chose de sacré». Publier une telle œuvre, qui procède d’une intention de l’auteur, n’a donc rien de transgressif; c’est rendre justice à l’écrivain, accomplir sa volonté, servir sa mémoire.
Servir sa mémoire ou la desservir, il arrive pourtant que l’on hésite. Comme Chateaubriand, mutatis mutandis, Drieu veut que le Journal qu’il a tenu entre 1939 et 1945 soit livré au public. Il donne pour instruction à son frère de le faire paraître après sa mort, « intégralement, sans hésitation bourgeoise ». Pourtant, Jean Drieu la Rochelle ne se résoudra à accomplir sa volonté qu’à la veille de sa propre mort, quarante ans plus tard. « Fallait-il publier ? Ne pas publier ? » se demande Pierre Nora dans sa Note de l’éditeur (1992). Publier ces pages, en effet, revient à révéler, ou à confirmer, « la haine de Drieu contre tous et tout, les femmes, les Juifs, ses meilleurs amis et lui-même » ; c’est aussi, peut-être, blesser certains lecteurs. Et est-ce, en définitive, servir la mémoire de l’écrivain?
On peut sans doute formuler la question autrement : une publication posthume ne doit-elle être entreprise que si elle sert la mémoire de l’écrivain ? Un héritier répondra vraisemblablement par l’affirmative. Un historien, pas forcément.
Pierre Nora énonce clairement les raisons pour lesquelles le Journal de Drieu paraît tout de même : Drieu a choisi de se placer sous le jugement de l’Histoire ; des éditions pirates, non contrôlées, menacent ; le Journal constitue un témoignage intéressant ; Drieu est un écrivain important. Il est à noter, cependant, que le livre sort dans la collection « Témoins », et non dans la « Blanche », qui avait accueilli en 1966 le grand roman posthume du même Drieu, Mémoires de Dirk Raspe. On ne saurait signifier plus simplement qu’une publication posthume ne fait pas systématiquement du texte publié une « œuvre ».
Casanova, Chateaubriand, Drieu et bien d’autres ont en commun d’avoir manifesté leur souhait que soient publiés les manuscrits qu’ils laissaient derrière eux. Mais toutes les publications posthumes ne peuvent s’abriter derrière la volonté exprimée de l’auteur. Certaines doivent au contraire remonter la pente d’une volonté inverse, exprimée elle aussi : celle que les inédits ne soient pas publiés, et même qu’ils soient détruits à la mort de l’auteur.
Les exemples célèbres ne manquent pas. On imagine l’embarras de L. Varius Rufus et de Plotius Tucca manipulant les coffrets qui contiennent 10 000 vers parmi les plus beaux de la langue latine et se demandant s’ils vont vraiment jeter au feu le chef-d’œuvre de P. Vergilius Maro, qui vient de trépasser, non sans les avoir priés de détruire son poème inachevé. Encore n’ont-ils pas l’occasion de barguigner longtemps. Le prince, Auguste, décide pour eux : c’est au public, non au bûcher, que sera livrée l’Énéide.
Il reste que les exécuteurs testamentaires n’ont pas toujours un imperator sous la main pour trancher à leur place. Que pense Max Brod en lisant la « dernière prière » de son ami Kafka : « tout ce que je laisse en fait de carnets, de manuscrits, de lettres, personnelles ou non, etc. doit être brûlé sans restriction et sans être lu » ? Peut-être a-t-il déjà en tête l’argument qu’il utilisera plus tard pour justifier sa décision de tout publier : lui, Brod, avait averti Kafka qu’il n’avait pas l’intention de brûler ses papiers. Si Kafka l’a néanmoins choisi comme « héritier littéraire », n’est-ce pas que, au fond de lui, il ne tenait pas vraiment à voir disparaître ses chefs-d’œuvre inédits ?
Cet argument — les écrivains ne veulent pas toujours ce qu’ils disent vouloir — connaît des variantes de toute sorte. À la veille de sa mort, en 1977, Vladimir Nabokov demande à sa femme de faire disparaître son roman en cours, L’Original de Laura. Vera Nabokov ne peut s’y résoudre, mais elle se garde de publier le livre. À sa mort, en 1991, son fils Dmitri hérite du manuscrit et du dilemme. Et c’est en 2009 seulement qu’il fait paraître le roman, dans l’état où son père l’avait laissé. On l’interroge, on s’inquiète, un livre aussi inabouti fait-il honneur à l’auteur de Lolita ? Dmitri Nabokov se rappelle alors qu’au cours d’une conversation son père avait mentionné Laura parmi ses livres importants. L’aurait-il cité s’il avait véritablement voulu qu’on le détruise ? Tout l’intérêt de cette question est que l’on ne peut absolument pas y répondre.
Pour Milan Kundera, qui aborde le sujet dans Les Testaments trahis, la situation est claire : en ne détruisant pas, puis en publiant les écrits posthumes de Kafka, Brod « a trahi son ami. Il a agi contre sa volonté, contre le sens et l’esprit de sa volonté ». Kundera va même plus loin : « Publier ce que l’auteur a supprimé est le même acte de viol que censurer ce qu’il a décidé de garder. » Mais il admire Kafka, en particulier ses romans, tous trois posthumes, c’est-à-dire sauvés des flammes par ce traître de Brod. « Qu’aurais-je fait moi-même dans la situation de Brod ? » se demande-t-il. Et d’avouer qu’il ne les aurait pas détruits, mais qu’il n’aurait consenti à cette transgression (limitée aux trois romans, précise-t-il : exit Le Terrier et les autres récits posthumes) qu’à ses propres « risques moraux »...
Tous les publicateurs de textes posthumes n’ont pas une telle exigence morale. Et il y a bien des façons de «trahir». Désireux que les Mémoires d’outre-tombe soient publiés, Chateaubriand n’était pas moins soucieux qu’ils ne le soient que cinquante ans après sa mort. Il dut pourtant renoncer à cette exigence pour des raisons financières. Il avait vendu l’œuvre à une société de souscripteurs qui dut elle-même, quelques années plus tard, accepter que le journal d’Émile de Girardin, La Presse, puisse en publier le texte, sous forme de feuilleton, dès le lendemain de la mort de l’écrivain. Lequel réagit vivement à cette nouvelle — « Je suis maître de mes cendres, et je ne permettrai jamais qu’on les jette au vent » —, avant de se résigner : « Je laisse passer, et je ne m’embarrasse pas de gens qui veulent voler jusqu’à mon cercueil. »
Du moins l’épisode rappelle-t-il que la décision de publication n’est pas le seul point délicat en matière d’œuvres posthumes. Les conditions de cette publication sont elles-mêmes un sujet sensible.
Parmi ses exigences, dont peu furent satisfaites, ce qu’avait bien vu Balzac qui s’y connaissait en impécuniosité (« Chateaubriand meurt de faim, il a vendu son passé d’auteur et il a vendu l’avenir »), le vicomte tenait à ce que ses ouvrages posthumes soient publiés dans leur entier, « et non par livraisons détachées ». Pourtant, on l’a dit, La Presse fera de son chef-d’œuvre un feuilleton.
En demandant une publication différée — d’un demi-siècle, ce qui n’est pas rien —, il comptait préserver sa liberté de pensée et d’écriture. À cela aussi il lui a fallu renoncer. Il en tire les conséquences : « si on était obligé de faire quelque sacrifice au despotisme des lois politiques du jour, que la place des passages supprimés soit laissée en blanc ; on remplira les lacunes dans la suite, lorsque les entraves de la presse ayant été brisées, il sera permis de produire le texte sans péril. » « On remplira les lacunes »… touchante confiance en l’avenir, et en sa propre destinée.
Ce qu’il n’avait peut-être pas anticipé, c’est la pusillanimité de ses premiers éditeurs, Charles Lenormant aidé de sa femme (nièce de Mme Récamier), et Maujard, qui avait été son secrétaire. Or leur établissement de texte se révèle timoré. Effrayés par les audaces de l’écrivain, ils les atténuent, pensant prévenir les critiques.
C’est le contraire qui se produit. Les premiers lecteurs de cette édition retouchée (1849-1850), à commencer par Sainte-Beuve, jugent l’œuvre inférieure à leurs attentes. L’auteur victime de ses éditeurs ? Il est clair que les publications posthumes ne sont pas sans risques. Elles soumettent les œuvres à un jugement fondé sur un texte non contrôlé par son auteur, jugement qui est, en cela, d’une autre nature que celui qu’exerce la critique sur des livres parus sous l’autorité dudit auteur. Car entre l’écrivain et l’écrit s’est glissé un intermédiaire, l’éditeur chargé d’établir le texte. Ce que l’on juge, dès lors, c’est à la fois le livre et la manière dont il est édité.
D’où un lieu commun : toute réédition d’une oeuvre posthume prétend réparer les outrages que lui ont fait subir les éditeurs précédents. Il s’agit de restaurer l’œuvre dans sa pureté, dans son « intégrité première », dit Edmond Biré quand il procure en 1898 une nouvelle édition des Mémoires d’outre-tombe. Mais cette intégrité est elle-même problématique. Les œuvres posthumes sont parfois inachevées, souvent inabouties, presque toujours difficiles à présenter. La question se pose donc de savoir si leur « intégrité » réside dans la mise à disposition du matériau brut (mais pour quelle lisibilité ?), dans une réélaboration de ce matériau (pour quelle authenticité ?) ou dans une solution de compromis (mais quelle ?). Il arrive qu’elle reste sans réponse, cette question, et qu’avec la meilleure volonté du monde l’« intégrité première » de l’œuvre soit introuvable.
Longtemps, on a tout fait — tout ce qui était permis, voire un peu plus — pour que les ouvrages posthumes offrent la même apparence homogène que les livres publiés par leur auteur. Quand c’était possible, l’inachèvement du texte ou l’inaboutissement du projet étaient minimisés, voire dissimulés. Peu d’amateurs de Stendhal savaient, en 1889, que l’édition originale posthume de Lamiel par Casimir Stryienski amalgamait des versions relevant de différentes époques de rédaction et nullement destinées à cohabiter. La première édition (1960-1962) d’Histoire de ma vie de Casanova établie d’après le manuscrit autographe proposait un texte redécoupé pour plus de régularité. Les premiers lecteurs des romans de Kafka ignoraient (Max Brod y ayant mis bon ordre) que l’auteur n’avait pas numéroté certains chapitres ni ne leur avait assigné de place définitive.
Il arrive aussi que l’éditeur d’un posthume soit — pour des raisons d’ordre esthétique, politique ou moral — un censeur. C’est l’un des reproches que Milan Kundera adresse à Max Brod : « Brod a édité le Journal de Kafka en le censurant un peu ; il en a éliminé non seulement les allusions aux putains mais tout ce qui concernait la sexualité. […] Ainsi, depuis longtemps, Kafka est-il devenu le saint patron des névrosés, des déprimés, des anorexiques, des chétifs, le saint patron des tordus, des précieuses ridicules et des hystériques. »
La charge est plaisante, mais l’art d’éditer les posthumes est difficile, et il serait déraisonnable d’estimer les travaux des éditeurs d’un autre temps à l’aune des usages et méthodes d’aujourd’hui. On a évoqué ici même (numéros 29 et 53 de la Lettre) les problèmes qu’ont posés à leurs éditeurs successifs les deux grands romans posthumes de Stendhal, Lucien Leuwen et Lamiel, et les solutions proposées par la Pléiade pour « restaurer » ces deux ouvrages. Encore ce terme, « restaurer », s’appliquerait-il mieux à un travail à la Viollet-le-Duc, conduisant à une « intégrité » en partie factice, qu’aux rigoureux (et astucieux) dispositifs éditoriaux mis en place par Xavier Bourdenet (pour Leuwen) et Serge Linkès (pour Lamiel), éditeurs « intègres » dans la mesure où ils savent qu’il ne leur appartient pas de se substituer à l’auteur pour achever ce qu’il n’a pas achevé, et pour verrouiller ce que, faute de temps, de liberté ou de désir, il a laissé ouvert.
Pourtant, la radicalité éditoriale n’est pas toujours bonne conseillère : impossible, par exemple, de procurer une édition lisible des Dialogues des carmélites en n’y incluant que ce qu’a écrit Bernanos. Mais lisibilité et authenticité ne sont pas incompatibles. Les bonnes solutions sont celles que dicte l’association de l’érudition et de la sensibilité. Pour rendre justice à Bernanos, la Pléiade publie en 2015 le dernier état de ses dialogues, y ajoute si nécessaire les indications scéniques figurant dans le scénario à partir duquel il a travaillé (et qui n’est pas de lui), et distingue visiblement, grâce à des artifices typographiques, ce qui est de la main de l’écrivain et ce qui appartient à d’autres.
Le temps n’est plus aux reconstitutions opaques. On attend de l’éditeur qu’il expose les principes qui l’ont guidé. Si l’écrivain a laissé son oeuvre ouverte, l’éditeur doit l’admettre. Il lui est demandé de n’intervenir qu’en cas de nécessité (ce qui revient bien souvent à peser des œufs de mouche dans des balances en toile d’araignée), et de savoir s’arrêter, de façon à ne pas devenir ce qu’il ne doit pas être : un coauteur.
Une fois établi le texte d’un ouvrage posthume, il reste à situer celui-ci dans les (ou en dehors des) œuvres, complètes ou choisies, de son auteur. Quelle place pour Lamiel au tome III des Œuvres romanesques complètes de Stendhal ? Dans une section séparée, pour marquer que le livre n’a pas le même statut que La Chartreuse de Parme ? Ou bien parmi les autres œuvres, à sa date d’(in)achèvement ? La réception de l’ouvrage sera différente selon la solution adoptée.
On sait que, dans le cas de Stendhal, c’est la chronologie qui a été retenue comme principe de classement des œuvres, qu’elles soient ou ne soient pas posthumes. Mais cette question n’appelle pas une réponse unique. Deux éditeurs peuvent faire des choix différents et tout aussi légitimes. Si l’histoire de l’œuvre et de sa publication ne change pas (sauf découverte décisive), les intentions et les usages éditoriaux varient considérablement.
Dans l’édition des Œuvres complètes de Kafka établie par Claude David à partir de 1976, le tome II mêle les nouvelles et récits publiés par Kafka (une faible part de sa production) et ceux dont l’édition est due à Max Brod. Au grand dam, une fois encore, de Milan Kundera, qui voit dans le résultat obtenu « un flot informe comme seule l’eau peut l’être, l’eau qui coule et entraîne avec elle bon et mauvais, achevé et non-achevé, fort et faible, esquisse et œuvre ».
Un flot sans doute, mais il dessine la trajectoire d’une écriture. Pourtant, la nouvelle édition qui paraîtra cet automne propose un autre dispositif. Le premier volume s’ouvre sur les recueils publiés par Kafka et sur les nouvelles qu’il a fait paraître en librairie ou dans la presse. Suivent les récits et fragments posthumes. Non plus une, mais deux trajectoires : qui lira cette édition « dans l’ordre » découvrira d’abord ce que les contemporains de Kafka ont pu lire. Pour les recueils conçus par l’écrivain, c’est une renaissance. Tout en se réjouissant que Brod n’ait pas consenti à l’autodafé, on redonne une visibilité aux décisions éditoriales prises par Kafka.
À l’inverse, alors que les Œuvres complètes de Georges Bataille parues dans la collection Blanche séparent ses « Œuvres littéraires » (tome III) et ses « Œuvres littéraires posthumes » (tome IV) — et cela, bien que les textes narratifs publiés par Bataille aient souvent connus une diffusion confidentielle —, au sommaire de la Pléiade textes anthumes et posthumes sont mêlés : la perspective est génétique. « Le lecteur pourra ainsi se former une idée de l’évolution que connaît l’écriture narrative de Bataille — ou de sa permanence », souligne le directeur de l’édition, Jean-François Louette, qui cite à l’appui de ce choix une phrase tirée de L’Expérience intérieure : « À l’extrémité fuyante de moi-même, déjà je suis mort, et je dans un état naissant de mort parle aux vivants »…
« Je parle de chez les morts », dit encore Bataille. Cette déclaration, Chateaubriand « assis dans [s]on cercueil » aurait pu la signer. Mais on n’en dira pas autant de tous les écrivains ayant laissé des inédits. Tous en effet n’ont pas travaillé à « se construire posthumes ». Les pièces de Molière imprimées après sa mort (et recueillies dans la Pléiade à leur date de publication) ne gagneraient rien à être classées comme le sont celles que Boulgakov n’a pu publier de son vivant (et qui sont placées dans la Pléiade à leur date de rédaction). Autant de livres, autant de dispositifs. Du « sur mesure », en somme. L’artisanat éditorial trouve à s’y employer.
Auteur(s) associé(s)



 Agrandir
Agrandir Diminuer
Diminuer