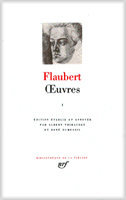La Pléaide
Recherche rapide
Le Cercle de la Pléiade
- La Pléiade /
- La vie de la Pléiade /
- Les coulisses de la Pléiade /
- «Comme disait le Duc d'Elbeuf...»

-
Nouveauté
René Descartes
Œuvres Tome IIParution le 7 Novembre 2024
En savoir plus
1584 pages, ill., Prix de lancement 72.00 € jusqu'au 31 12 2024
-
L'histoire de la Pléiade
Anniversaire. Henri Michaux (24 mai 1899 – 19 octobre 1984) Novembre 2024En savoir plus
«Comme disait le Duc d'Elbeuf...», brêves considérations sur les nouvelles éditions.
La lettre de la Pléiade n° 37septembre-octobre 2009
Ces jours-ci paraît la nouvelle édition des Œuvres complètes de Lautréamont. Mais qu’est-ce au juste qu’une «nouvelle édition» ? Pourquoi la Pléiade éprouve-t-elle le besoin ou l’envie d’en inscrire à son programme de nouveautés ?
Et en quoi sont-elles des « nouveautés » plutôt que des « réimpressions » ?
Même corrigée, mise à jour, voire lestée d’un Supplément, une réimpression n’est ni une « nouveauté » ni une « nouvelle édition ». Il s’agit toujours du même ouvrage, présenté à l’identique par les mêmes éditeurs. Significativement, la vignette ornant l’étui du volume n’est jamais modifiée à l’occasion d’un retirage.
Rien à voir, par conséquent, avec une « nouvelle édition ». Cette appellation est réservée aux volumes ou aux ensembles de volumes consacrés à des œuvres déjà présentes au catalogue (en totalité ou pour partie), réalisés selon des principes nouveaux et suivant un plan qui leur est propre, confiés à des éditeurs distincts de ceux qui ont établi les anciennes éditions, dotés d’un appareil critique conçu et rédigé spécialement pour l’occasion, et paraissant parfois sous un titre nouveau, voire avec une tomaison différente. Pierre Lièvre publia en 1934 un Théâtre complet de Pierre Corneille en deux volumes ; Georges Couton, entre 1980 et 1987, procura une nouvelle édition en trois volumes, intitulée Œuvres complètes et incluant non seulement le théâtre, mais aussi les textes non dramatiques de l’auteur. Tout était nouveau dans les volumes de Georges Couton : l’appareil critique, bien sûr, mais aussi, nous y reviendrons, le choix du texte de référence.
Ajoutons que la Pléiade publia en outre, surtout dans les années 1950, des éditions complétées, qui tenaient le milieu entre la réimpression et la nouvelle édition. Ce fut le cas, précisément, pour Corneille : en 1950, Roger Caillois se chargea d’apporter des compléments (et non pas un Supplément) à l’édition de Pierre Lièvre, sans pour autant la refondre. Mais on peut passer rapidement sur cette pratique, qui n’a plus cours, et s’interroger plutôt sur les motifs qui conduisent un éditeur à supprimer de son catalogue des éditions exploitées pendant plusieurs décennies, et qui restent souvent de bonne vente, pour les remplacer par d’autres, qui nécessitent trois, quatre ou dix ans de travail et exigent un lourd investissement — le tout au risque de voir bon nombre de lecteurs s’en tenir à leur vieux volume, familier, amical, chargé de souvenirs, ou même se moquer de leur collection préférée en retournant contre elle la chanson de Brel : Car comme disait le duc d’Elbeuf : / C’est avec du vieux qu’on fait du neuf (bis)…
Ces motifs existent bel et bien. Les uns sont propres à l’histoire de la collection ; d’autres sont communs à toute la profession : la plupart des éditeurs de textes proposent régulièrement de nouvelles éditions des titres déjà parus. Si les grands livres ne vieillissent pas (certes ils changent, parce que le regard porté sur eux change, mais il s’agit là de métamorphose et non de sénescence), la manière de les éditer et de les annoter, elle, varie d’âge en âge. Sans parler de la manière de les traduire.
|
|
|
|
|
Aux temps héroïques de la Pléiade, les classiques de la littérature étrangère — Shakespeare ou Cervantès, pour s’en tenir aux géants — étaient publiés dans des traductions anciennes : les traducteurs de Cervantès, César Oudin et François de Rosset, étaient des gens de lettres vivant au tournant du XVIe et du XVIIe siècle et dont le travail fut simplement modernisé ; ceux de Shakespeare étaient pour l’essentiel des écrivains (Maeterlinck, Gide, Jouve et consorts) ou les fils de leur père (François-Victor Hugo) : leurs traductions furent reprises en l’état. Elles n’étaient pas dépourvues de qualités. Mais elles étaient tributaires de l’horizon esthétique de leur temps. La décision de confier à Jean Canavaggio (Cervantès) et à Jean-Michel Déprats (Shakespeare) la direction de deux grands chantiers de traductions nouvelles était fondée sur un constat : les traductions vieillissent ; le français évolue ; il conserve, et c’est heureux, la faculté de restituer la magie des œuvres anciennes, mais il faut employer, pour y parvenir, d’autres moyens qu’au siècle dernier ou au précédent. On se tromperait en imaginant que l’« adaptation modernisante » — la suppression de la distance qui existe entre les œuvres et nous — fait partie de ces moyens. Au contraire, les traductions du Quichotte ou de Macbeth récemment publiées dans la Pléiade sont respectueuses de la double altérité — spatiale et temporelle — des textes. Il n’empêche qu’elles sont de notre temps. Ce qui signifie qu’elles seront peut-être à refaire dans un demi-siècle : dura lex.
C’est donc la volonté de rendre justice aux chefs-d’œuvre d’autrefois avec les moyens d’aujourd’hui qui a conduit la Pléiade à éliminer de son catalogue les éditions anciennes de Cervantès et de Shakespeare pour les remplacer par celles qui sont actuellement disponibles ou en cours. La prise en compte de la théâtralité des œuvres et la volonté de publier une édition bilingue furent également, pour Shakespeare, des motifs décisifs. Enfin, ces nouveaux volumes offrirent l’occasion d’adjoindre aux traductions nouvelles un appareil critique entièrement neuf — ce qui n’est pas une mince affaire, compte tenu de l’ampleur des recherches consacrées à ces deux monstres sacrés.
Qu’en est-il de la littérature française ? La nécessité de renouveler l’appareil critique, de le concevoir selon les normes actuelles de la collection, d’y incorporer les acquis les plus importants de la recherche la plus récente (pour autant qu’ils constituent de réels apports pour le large public de la Pléiade) est un élément qui compte pour Proust et Lautréamont non moins que pour Shakespeare et Cervantès. On aurait tort, pourtant, de penser que la préparation d’une nouvelle édition de littérature française se borne à cela. Le texte lui-même doit être renouvelé, ce qui peut nécessiter, en particulier pour les œuvres posthumes, de lourds travaux.
|
|
|
|
|
Dans bien des cas, la nouvelle édition propose un établissement du texte fondé sur des principes nouveaux. Dans son Corneille déjà cité, Georges Couton va contre une tradition bien ancrée : des premières pièces au Cid inclus, il reproduit le texte des éditions originales en lieu et place de celui de l’édition défi nitive de 1682. Même choix, plus radical encore, pour le Racine établi en 1999 par Georges Forestier : toutes les pièces, cette fois, sont publiées d’après les éditions originales, et non d’après l’édition testamentaire de 1697. Nuance réservée aux experts ? Voire. De telles décisions, a priori peu visibles, ont en réalité d’assez considérables conséquences esthétiques et idéologiques, que les appareils critiques exposent à loisir, mais dont un lecteur un tant soit peu averti s’apercevra lui-même. Quant à substituer, comme l’a fait la Pléiade en mai 2007, le texte des Essais de 1595 à celui de l’exemplaire dit « de Bordeaux », c’est rendre à nouveau disponible la version des Essais la plus complète, la plus aboutie, la plus homogène, et la seule que connurent Descartes, Pascal, Rousseau, Diderot et tous les lecteurs de Montaigne jusqu’à la fin du XIXe siècle. On se souvient peut-être, dans le même ordre d’idées, du petit événement que constitua en octobre 2007 la nouvelle édition du tome II des Œuvres romanesques complètes de Stendhal : pour la première fois, on renonçait à reproduire la version hybride de Lucien Leuwen qui avait cours jusqu’alors (voir la Lettre n° 29). Le public ne s’y est pas trompé, qui a réservé un très bon accueil à ce volume ; il pourra d’ailleurs constater, quand paraîtra le tome III, que le texte réétabli de Lamiel offre une vision radicalement neuve de cette œuvre importante (et que le nouvel appareil critique de La Chartreuse de Parme est, soit dit en passant, brillantissime).
Mais le « cas Stendhal » est intéressant aussi pour une autre raison : la nouvelle édition conçue par Philippe Berthier et ses complices fut l’occasion d’une réorganisation de l’œuvre romanesque de Stendhal. Pour la première fois (cela paraît étonnant, mais il en est bien ainsi), celle-ci fut présentée dans l’ordre chronologique de rédaction et débarrassée des regroupements artificiels qui s’étaient imposés après la mort de l’auteur. De même, les Œuvres complètes de Camus, qui ont succédé aux deux volumes établis dans les années 1960, renoncent aux classements fondés sur le genre littéraire et optent pour un plan simple, chronologique, ce qui, pour Camus, est très riche d’enseignements. De même encore, les nouvelles Œuvres complètes de Molière qui [information confidentielle] paraîtront au printemps prochain bouleversent les idées reçues en présentant les pièces dans leur ordre de publication — ce qui, pour Molière, change sinon la face du monde, du moins pas mal de choses, comme on le verra. On multiplierait les exemples sans difficulté : les nouvelles éditions proposent toujours de nouveaux plans, qui conduisent parfois à une vision neuve des œuvres. Il ne s’agit donc pas de changer pour le plaisir de changer, mais d’imaginer le dispositif le plus efficace, au service de l’œuvre qu’on tâche de mettre en valeur.
|
|
|
|
|
Il arrive, enfin, qu’une nouvelle édition soit rendue nécessaire, ou désirable, par le changement de statut ou de dimension d’un écrivain. Le Diderot qu’accueillit la Pléiade en 1935 n’était pas celui que nous connaissons aujourd’hui au terme d’une reconnaissance qui fut très progressive : Diderot n’a cessé de « grandir » pendant tout le xxe siècle. Quant à Flaubert, ses éditeurs de 1936 estimaient que l’on pouvait s’en tenir aux œuvres publiées de son vivant (à quoi ils ajoutaient tout de même Bouvard et Pécuchet), ce qui n’est plus notre cas. Et ne parlons pas de Proust, dont la connaissance et peut-être le plaisir que nous prenons à sa lecture ont été enrichis par la révélation, entre 1987 et 1989, des Esquisses tirées de ses cahiers de brouillons.
L’édition critique, ou semi-critique, peu importe le nom qu’on lui donne, est un artisanat qui, pour ne pas finir au musée des inventions inutiles, doit se renouveler en permanence, non seulement en s’intéressant à de nouveaux auteurs (ce qui va de soi), mais aussi en se tenant au plus près de la spécificité des œuvres éditées : excellent exercice, qui exige souplesse et à-propos.
Les nouvelles éditions sont l’un des moyens de cet indispensable renouvellement. Chacune d’elle est pour l’œuvre un habit sur mesure. Il ne s’agit pas de le tailler au goût du jour, mais de faire en sorte qu’il soit adapté à l’époque où (et à la manière dont) l’œuvre fut écrite et diffusée aussi bien qu’à notre temps, où elle va être lue. Sans doute la structure du Rimbaud publié par André Guyaux en février dernier, et qui a connu un grand succès, aurait-elle été impensable il y a un demi-siècle. Elle nous paraît aujourd’hui convenir idéalement à cette œuvre brève, éparse et peu publiée par son auteur. Mais il ne serait guère avisé de l’adopter pour un poète qui aurait poli ses textes lors de chacune de leurs rééditions. L’éditeur n’est pas chargé de défaire ce que l’auteur a patiemment bâti. Il peut s’estimer satisfait s’il parvient à tracer, entre l’œuvre et son lecteur, des chemins commodes, et sur lesquels il sera agréable de flâner.



 Agrandir
Agrandir Diminuer
Diminuer